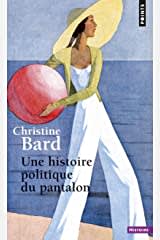Traduire Annie Ernaux. Perspectives socio-stylistiques
https://www.fabula.org/actualites/126416/traduire-annie-ernaux-perspectives-socio-stylistiques.html
« Traduire Annie Ernaux, c’était stimulant mais pas facile. Elle a un style très spécial. Quand on dit qu’elle écrit simplement, ce n’est pas vrai. Ce n’est pas plat ». C’est ainsi que le traducteur Hector Poullet, évoque les difficultés qu’il a rencontrées lorsqu’il a cherché à transposer le style ernausien au créole (déclaration à l’AFP, avril 2023). Avec cette traduction (Plas-la, Caraïbéditions, 2023), menée à l’initiative des éditions Gallimard, Annie Ernaux est ainsi devenue la première personne non-antillaise à être traduite de son vivant en créole. De même, la traductrice espagnole Lydia Vázquez déclare à propos de La Place « C'est un livre, comme tous les livres d’Annie, qui a l’air d'adopter une écriture plate, une écriture blanche, comme on la décrit souvent. Pourtant, c’est une écriture qui est très exacte. Il faut donc essayer d’être aussi précis et juste qu’elle, ce qui n’est pas évident. Ce sont des textes difficiles à traduire » (entretien avec Marion Mergault, Le Petit Journal, publié le 02 février 2024).
Réfléchir à la traduction d’Annie Ernaux, c’est donc l’occasion de revenir sur les subtilités de son style, subtilités trop souvent balayées à la faveur du succès de la formule « d’écriture plate ». Mais c’est aussi comprendre comment un style, défini par son autrice contre les canons dominants, a pu devenir, si ce n’est dominant, du moins reconnu par des instances de légitimation internationale (tel le Nobel en 2022) et comment il peut circuler dans le monde entier. Ce colloque, mené dans le cadre du projet TRANSILANGUE (laboratoire POLEN), se propose précisément de revenir sur les enjeux propres à la traduction d’Annie Ernaux, dans une perspective socio-stylistique, et aura lieu les 19 et 20 mai 2025. Il s’agit bien d’étudier un style littéraire d’autrice, mais en comprenant la construction, la reconnaissance et la légitimation de ce style non pas comme le pur fruit d’une inspiration individuelle mais comme un processus de négociations avec différentes instances sociales et institutionnelles.
Programme
https://www.fabula.org/actualites/126416/traduire-annie-ernaux-perspectives-socio-stylistiques.html
Lundi 19 mai
Matin
À partir de 9h - Accueil et petit déjeuner
9h30-10h - Clara Cini (Sorbonne Université), Sara De Balsi (CY Cergy-Paris Université), Laélia Véron (Université d'Orléans) : Mot d’ouverture et introduction
10h15-11h - Paola Boué (City University of New York), ouverture : “ Réception internationale et évolution du discours sur le style : l’exemple des Etats-Unis”. Échanges
Présidence : Mauro Cazzolla
11h-11h30 - Alice Ray (Université d'Orléans) : “Le traitement des phrases averbales dans la traduction en anglais de La Place”
11h30-12h - Arezou Dadvar (Sorbonne Nouvelle) : “Réécrire l’intime : La Honte et Une femme d’Annie Ernaux en persan, face aux défis sociopolitiques et éditoriaux en Iran”
12h-12h30 - Ornella Tajani (Université pour étrangers de Sienne) : “Traduire et retraduire l’autosociobiographie ernausienne en italien (Une femme et La Honte)”
12h30-13h - Échanges et questions
13h-14h - Déjeuner
Après-midi
Présidence : Bérengère Morichaud-Airaud
14h-15h15 - Ateliers de traduction et de réécriture (avec un moment de lecture des productions)
-en italien : Sara De Balsi (CY Cergy-Paris Université), Ornella Tajani (Université pour étrangers de Sienne) et Biagio Ursi (Université d'Orléans)
-en anglais : Alice Ray (Université d'Orléans), Cécile Hébrard (lycée Pothier, Orléans)
15h15-15h30 - Pause café
15h30 - Jovanka Šotolová (Université Charles, Prague) : “La réception tchèque de l’œuvre d’Annie Ernaux (La Place et Une femme)”
16h - Sabine Kraenker (Université d'Helsinki) : “Les enjeux de la traduction d’Annie Ernaux en finnois dans une perspective socio-stylistique, à travers l’exemple de Passion simple”
16h30 - Tatiana Rangel (Sorbonne Université) : “Traduire l’écriture plate en portugais du Brésil. L’exemple de Passion simple”
17h-17h30 - Échanges, questions et clôture de la première journée
Mardi 20 mai
Matin
À partir de 9h - Accueil et petit déjeuner
Présidence : Cécile Chapon
9h30 - Michel Nachaat (Université Ain Shams, Le Caire) : “Les désignateurs de référents culturels dans la traduction arabe de Regarde les lumières mon amour”
10h - Solange Gil (traductrice) : “Comment j’ai traduit Annie Ernaux en rioplatense” (Journal du dehors et La Vie extérieure)
10h30-11h - Échanges et questions
11h-12h15 - Atelier de traduction/réécriture
-en espagnol : Cécile Chapon (Université de Tours), Clara Cini (Sorbonne Université) et Solange Gil (traductrice)
-en croate : Nina Rendulic (Université d'Orléans)
12h15-13h30 - Déjeuner
Après-midi
Présidence : Claire Stolz
13h30-14h - Anne-Claire Cassius (Université des langues étrangères de Nagoya) : “La traduction japonaise de L'Événement et sa réédition en format poche”
14h-14h30 - Rokus Hofstede (traducteur) : “La médiation des realia dans Les Années”
14h30-15h - Échanges et questions
15h-15h30 - Pierre-Alain Caltot (Université d'Orléans), ouverture finale : “ Traduction et réécriture : Annie Ernaux en latin”
15h30-16h - Derniers échanges et mot de clôture
16h-16h30 - Café final
- Responsable :
Laélia Véron - Url de référence :
https://www.univ-orleans.fr/fr/polen/les-membres/les-membres-de-cepoc/laelia-veron - Adresse :
Hôtel Dupanloup (1 rue Dupanloup - 45000 ORLÉANS) - voir sur une carte